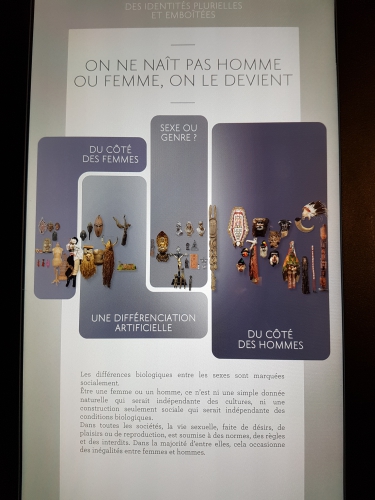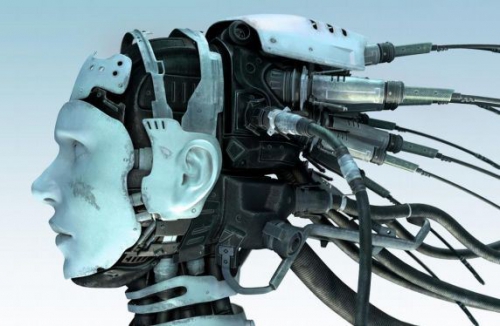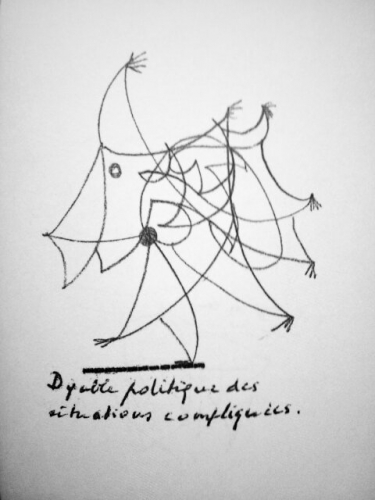Rechercher : michéa
Le vrai visage du libéralisme [2]
Une lecture de Michéa :
- « Société ouverte » et politique de la nécessité :Le libéralisme se présente donc comme le projet d'une société minimale dont le Droit définit la forme et l'Economie le contenu, sans la moindre référence à des valeurs morales et culturelles partagées. Ses défenseurs ont prévu une position de repli plus présentable : l' « esprit de tolérance » et le « refus du rejet d'autrui », comme éthique de substitution. Toute la question est de savoir ce que recouvre ici ce concept ambigu de tolérance.
La plupart des dispositifs de pacification effective de l'Europe moderne trouvent leur point de départ véritable au XVIème siècle, dans l'action des intellectuels et hommes de pouvoirs. Ceux-ci sont tous convaincus, à la différence des Humanistes classiques, que la fin des guerres de religion et un nouvel équilibre entre les puissances européennes ne pourrait être obtenus que dans les règles strictes du « réalisme politique ». Cette position supposait que toutes les parties en présence acceptent désormais de faire abstraction de leurs certitudes en matière religieuse ou de « vie bonne ». L'exigence du compromis historique, dans l'esprit des Politiques, consistait seulement en une stratégie du moindre mal.
Ce n'est que dans le cadre de cette anthropologie désabusée qu'il est possible de comprendre le recours constant, à partir du XVIème siècle, à l'idée métaphysique de « nécessité », clé de voûte philosophique de toutes les constructions politiques modernes, y compris sous la forme des idées de « Croissance » et de « Progrès ». Au nom de cette nécessité, sensée résoudre le penchant des hommes pour la violence, la survie collective devait donc passer par une mise en retrait de tout appel à la conscience morale ou religieuse.
Ce pessimisme fondamental conduisait ainsi à trouver les moyens pratiques de neutraliser l'action des différentes morales, philosophies et religions, sources de tous les maux, par une gestion purement technique et instrumentale de la « nécessité ». Le nouveau vocabulaire technique se substitue aux rhétoriques du Bien et du Salut, et constitue une des sources idéologiques les plus immédiates de la réponse libérale au problème politique moderne.
On est loin de la belle légende des sources humanistes de l'Occident. Le compromis moderne consiste en un accommodement de son existence dans le cadre purement technique d'un modus vivendi, et en une privatisation des convictions morales et religieuses. La tolérance n'est ici qu'une manière froidement minimaliste de coexister avec ses contemporains. Quel rapport avec la «tolérance» telle qu'un Erasme ou un Montaigne entendaient encore sous ce mot ? Quel rapport avec ce travail long et complexe que chacun doit opérer sur lui-même pour se défaire de son égoïsme et apprendre à regarder le monde avec les yeux d'autrui ?
C'est encore Milton Friedman qui a décrit avec le plus d'exactitude cynique la nature de la tolérance libérale, quand il célèbre dans le Marché le mécanisme magique permettant d'unir quotidiennement « des millions de gens, sans qu'ils aient besoin de s'aimer, ni même de se parler ». Selon cette définition, l'Autre est beaucoup moins le partenaire possible d'une rencontre toujours singulière que pur objet de consommation ou d'instrumentalisation.
- Tractacus juridico-economicus : La défiance radicale envers les capacités morales des êtres humains, envers leur aptitude à vivre ensemble sans se nuire réciproquement, est au cœur de l'institution imaginaire des sociétés modernes. Le projet libéral se fonde dans cet antihumanisme qui présuppose un homme incapable de vrai et de bien. Ces politiques modernistes cherchent la moins mauvaise société possible, et se résignent à considérer les hommes «tels qu'ils sont».
Les mécanismes auto-régulateurs du libéralisme doivent d'abord être compris comme la matérialisation de cette méfiance originelle envers les capacités morales de l'humanité. Face au crime qui contient tous les crimes (l'idéal éthique tenu pour universalisable), il convient donc, au nom de la tranquillité et de la paix civile, de neutraliser toutes les formes de la tentation morale, religieuses ou non. Une double stratégie est donc mise en œuvre à cette fin : d'une part la désinstallation de toutes les figures traditionnelles de l'autorité politique, et de l'autre, le placement progressif de l'existence collective des individus sous le contrôle de mécanismes impersonnels et idéologiquement «neutres». Comme on le sait, pour les libéraux, il n'existe que deux mécanismes possédant cette propriété providentielle, ces deux horlogeries parallèles et complémentaires que sont le Marché et le Droit.
Pour optimiser cette société-machine et comme condition à son libre fonctionnement, il est indispensable que l'Etat libéral sépare soigneusement l'exercice du pouvoir politique et toute considération morale ou religieuse. Mais plus encore, défendre les conditions du laisser-faire le conduit à devoir briser les résistances culturelles au «changement», fondées dans les «archaïsmes» de la tradition. Il est en cela investi d'un devoir régalien de «faire évoluer les mentalités», toujours au nom de la nécessité perpétuelle de garantir à chacun la possibilité effective de jouir paisiblement de ses droits et de son indépendance privée.
Les rouages de cette société fonctionnent donc d'autant plus que chaque individu renonce de lui-même à quelque travail sur lui-même et à quelque aspiration à la vie intérieure, pour y préférer la poursuite plus tranquille de ses intérêts bien compris et de ses désirs particuliers. C'est seulement à partir de cette nécessité préventive de dissuader les individus de céder à la tentation morale, que l'on peut comprendre, dans leur logique profonde, les évolutions parallèles du Droit et du Marché modernes.
Contrairement aux différents Droits traditionnels qui s'en référaient à une morale fondatrice, le droit libéral se fonde dans sa neutralité axiologique. Il se prévaut donc d'une rationalité essentiellement calculatrice et procédurale, sans aucun recours à la question du bien-fondé métaphysique ou non des revendications en présence. Mais, de part cette logique même, le droit libéral est conduit à dévaler des pentes beaucoup plus raides. Ici, il semble bien que seule l' «évolution des moeurs» soit en mesure d'apporter les informations nécessaires, en éclairant à chaque étape, les présupposés demeurés jusque là inconscients du Droit constitué.
De cette manière, apparaissent sans cesse de nouveaux motifs d'indignation, fondant ainsi les exhortations libérales à de « nouvelles avancées du Droit ». Ainsi le juriste libéral Daniel Borillo s'étonne que, deux siècles après la Révolution française, nous soyons toujours privés du droit élémentaire de «fouetter notre partenaire s'il nous le demande, même si cela nous procure du plaisir». Et Borillo n'a évidemment aucun mal à démasquer le présupposé moralisateur caché qui fonde cette atteinte intolérable à la liberté individuelle. Et oui, des juges prennent encore parfois appui sur l'étrange «notion de dignité humaine», donc sur une certaine idée de l'humain.
Traquant les «préjugés moralisateurs», le programme d'épuration libérale du Droit (ou, comme préfèrent dire les libéraux de gauche et d'extrême-gauche, la « lutte contre toutes les discriminations et contre toutes les exclusions ») se découvre donc, lui aussi, voué par nature au mouvement sans fin. Son seul terme logique ne pourrait être que la reconnaissance officielle de ce que Hobbes avait appelé le droit de tous sur tout.
La contrainte libérale de neutralité axiologique absolue produit, bien entendu, des effets identiques dans l'ordre parallèle du Marché, dont le libre développement a pour nom Croissance, unique fondement du lien social moderne selon les libéraux. Que son taux diminue ou chute, et la pacification du lien social s'en trouvera donc menacée dans ses fondements.
La Croissance étant l'alpha et l'oméga du salut politique des hommes, il est ainsi nécessaire que la concurrence soit « libre et non-faussée », et que chaque agent opérant sur ce marché idéal (producteurs ou consommateurs), accepte de jouer le jeu, en s'efforçant de maximiser son utilité. Cela implique que ces agents ne se laissent jamais infléchir par de douteuses considérations morales ou idéologiques des effets de leurs décisions « rationnelles » sur les équilibres de la nature et de l'humanité. Selon les économistes, ces effets collatéraux de la Croissance sont de simples « externalités » négatives qu'il s'agit de laisser hors champ, car ils ne sont pas mesurables, et surtout parce qu'ils ne pourraient être appréciés qu'à l'aune de critères « idéologiques ».
Considérer par exemple que l'industrie du divertissement et de la manipulation publicitaire logotomisent des franges entières de la jeunesse, dépossédées de leur propre humanité, supposerait en effet de s'en référer à une certaine idée de l'humanité.
En toute cohérence philosophique, les propagandistes du Système travaillent donc à exclure de leurs calculs économiques tout ce qui pourrait s'apparenter à un jugement de valeur, comme par exemple dans leur mode d'évaluation du PIB, censé mesurer « scientifiquement » la Croissance.
Selon cette méthodologie positiviste qui définit le bonheur libéral par l'exclusion méthodologique de la common decency, il est a contrario parfaitement sensé de prendre en compte la production des marchandises les plus inutiles et absurdes, mais également les nuisances les plus avérées du mode de destruction capitaliste de la nature et de l'humanité ; autant de maux et de tragédies, ne l'oublions pas, s'inscrivant dans la logique de la nécessité d'une perfection plus grande, ici celle du taux de croissance, horizon de l'empire du moindre mal.
En ce sens, dès 1849, Thomas Carlyle, définissait l'économie politique comme la science lugubre par excellence.
Les processus du Droit et du Marché peuvent ainsi se développer dans un parfait parallélisme, car les raisons qui commandent ce double développement sont structurellement identiques. L'épuration éthique est la contrepartie pratique de ce renoncement à «penser la vie humaine selon son bien ou selon sa fin» qui organise philosophiquement l'ensemble du dispositif libéral. Ce processus sans sujet doit également se déployer sans fin : c'est donc la notion même de limite qui devient philosophiquement impensable. Pour en légitimer le principe, il faudrait en effet pouvoir s'appuyer sur des valeurs morales.
C'est donc sous l'effet de sa propre logique qu'une société libérale se trouve contrainte de révolutionner constamment l'ensemble des rapports sociaux et humains. Ce constant ébranlement de tout le système social distingue l'époque bourgeoise de toutes les précédentes (cf Marx). «Le but final n'est rien et le mouvement est tout » (Eduard Bernstein).
(à suivre)
07/08/2013 | Lien permanent
Sur Mai 68 : un regard ”catholique social”
m
m
[ Le texte ci-dessous, dont je suis l'auteur, est l’introduction de Liquider Mai 68 ? (Presses de la Renaissance), ouvrage collectif sous la direction de Chantal Delsol et Matthieu Grimpret. Ont aussi contribué à ce livre : Denis Tillinac, Christophe Durand, Jean Sévillia, Jean-Marie Petitclerc, Paul-Marie Coûteaux, Sarah Vajda, Antoine-Joseph Assaf, Jacques Garello, Ludovic Laloux, Elsa Godart, François Grimpret, Jean-Louis Caccomo, Pierre Guénin, Steve Frankel, Michelle d’Astier de La Vigerie, Ioanna Novicki, Dominique Folscheid, Ilios Yannakakis. En librairie le 15 avril. Blog du livre : http://liquidermai68-lelivre.blogspot.com/ ]
> Ce texte étant assez long, les commentaires sont à envoyer dans la note suivante créée à cet effet.
m
m
LA REPENTANCE N'EST PAS DANS L'AIR
m
Liquider Mai 1968 : vaste programme, eût dit de Gaulle. Il faut voir où l’on met les pieds.
Peut-on regarder 68 comme un drame politique dont on pourrait dresser le bilan, à la façon des Livres noirs du communisme et du colonialisme ?
Ce serait une erreur.
J’en témoigne. J’avais vingt ans cette année-là et j’étais sur le terrain. Etudiants « réacs » [1] de Nanterre et du Quartier latin, nous nous sommes bien amusés – mais sans y croire une seconde ! Nous ne sommes pas allés sur les Champs-Elysées le 30 mai. Pas un instant nous n’avons gobé que « les rouges » voulaient « prendre le pouvoir ». Ni que la « révolte étudiante » était « dirigée et exploitée par des meneurs au service d’une puissance sans visage qui agit partout à la fois dans le monde », comme l’écrivait alors Mauriac dans son bloc-notes... La panique bourgeoise nous faisait rire. La droite jouait à la contre-révolution, mais il n’y avait pas de révolution ; les cris de guerre des gauchistes sonnaient faux, leurs slogans avaient l’air d’un décor. La société qu’ils dénonçaient n’existait pas. Le danger qu’ils proclamaient (la « fascisation du capitalisme ») était imaginaire et absurde.
Mais nous qui étions dans le bain, contrairement à la droite, nous sentions qu’il y avait tout de même un esprit du mouvement de Mai : et que cet esprit était autre chose que son apparence.
On devinait un volcan qui n’était pas politique [2].
Sous les gesticulations pseudo-marxistes courait en réalité une fièvre irrésistible d’individualisme, vouée à brûler tout ce qui paraissait freiner encore un peu le règne de l’ego.
Mai 68 allait aider – sans le vouloir – à installer une société consumériste, fondée sur l’exploitation commerciale des pulsions du Moi les plus déshumanisantes : une société où le travail allait devenir aussi flexible que la morale, comme dans le film de Ken Loach It’s a free world [3]. Cette société allait fusionner la gauche et la droite comme des gérantes du même hypermarché. Pierre Legendre l’écrira en 2001 : « Notre société prétend réduire la demande humaine aux paramètres du développement, et notamment à la consommation »[4] .
Pour que la société puisse devenir ce terrain vague, il fallait raser les ultimes valeurs supérieures à l’individu, les dernières « haies », les vestiges d’un art de vivre plus ancien que la bourgeoisie moderne.
Cette destruction fut l’œuvre de l’esprit de 68. Il a agi comme un incendie. Ce n’était pas difficile : les « haies » étaient desséchées par le néant moral des Trente Glorieuses... « Notre mode de vie focalisé sur le confort et l’utilitaire ne satisfait pas la jeune génération », affirmait en 1967 le journaliste italien Giorgio Bocca. Son diagnostic surestimait le mobile des jeunes, mais il était presque exact sur un point : la faillite éthique des vieux.
La prophétie de Boutang
Quelqu’un avait vu cette faillite plus nettement, en France, deux ans avant 1968. C’était le philosophe Pierre Boutang, et sa vision [5] a l’air d’une prophétie lorsqu’on la relit en 2008 :
« Une part de la réalité de l’homme est en train de s’évanouir, ou changer de sens ; subissant à la fois les techniques de massification (perdant de plus en plus son visage, la ressemblance avec Dieu) et la rhétorique de l’humanisme le plus vague et dégoulinant, le citoyen des démocraties modernes et développées a laissé tomber […] sa réalité d’homme, vivante et en acte. Il a cessé d’agir comme père, d’exercer comme un père une autorité familiale (or nul n’est homme s’il n’est père, dit Proudhon). […] Pour cela, les fils s’éloignent (même en restant là) et haïssent ou méprisent à la fois le fils que fut leur père, et le père qu’il n’est pas. Leur ‘‘protéïsme’’, leur capacité de désir de prendre toutes les formes animales, jusqu’au refus du visage humain et de la détermination sexuelle, n’est que le constat d’absence, mais d’absence molle et pesante, d’un être de l’homme, à l’image de Dieu, chez l’adulte. »
Ce texte de 1966 était une prémonition du processus de Mai 68 :
- d’abord la nullité morale des pères, bourgeoisie « traditionnelle » déboussolée qui s’attirait le mépris des enfants ;
- puis la dislocation psychologique des enfants, « jusqu’au refus du visage humain et de la détermination sexuelle ».
En mai 2008 ces enfants ont la soixantaine. Leur refus de naguère est devenu l’esprit d’une néo-bourgeoisie : l’âme d’un monde sans âme, où la droite et la gauche desservent par roulement – à des heures différentes – le rayon des « nouvelles mœurs » à l’enseigne du Grand N’importe Quoi. Le philosophe Bernard Stiegler conclut [6] à leurs torts partagés :
« On a souligné un paradoxe à propos de Mai 68 : on a pensé que le capitalisme était porté par la droite, qui défend les ‘‘valeurs traditionnelles’’, et que c’est un mouvement de gauche (Mai 68) qui a voulu symboliquement détruire ces valeurs. Mais en réalité, ce qui a réellement organisé cette destruction des valeurs, c’est le capitalisme… Le capitalisme est contradictoire avec le maintien d’un surmoi… Une société sans surmoi s’autodétruit. Le surmoi, c’est ce qui donne la loi comme civilité. Un récent rapport du préfet de la Seine-Saint-Denis expliquait la violence dans les cités par cette absence de surmoi, qui se traduit alors par le passage à l’acte… »
Selon la formule d’un autre philosophe de 2008, Jean-Claude Michéa, il est « impossible de dépasser le capitalisme sur sa gauche ». Ainsi les postures dominantes aujourd’hui sont libérales-libertaires : elles cultivent les transgressions « qui servent à la bonne marche des affaires » ; « elles rompent les solidarités effectives, en isolant plus encore l’individu dans une monade où se perd ‘‘le goût des autres’’, où il n’est plus qu’un rouage. [7] »
En détruisant le français et l’histoire à l’école, par exemple, les pédagogues post-68 ont fait table rase au profit de l’idéologie marchande – qui exploite l’amnésie et parle en basic english.
Mai 68, portier du matérialisme mercantile
Mai 68 n’est donc pas l’antithèse de 2008.
Il n’est pas l’inverse de notre société libérale-libertaire (ou ultralibérale, c’est la même chose).
Il n’est pas l’opposé de « notre monde postmoderne avec sa politique cacophonique et vide, et sa contre-culture devenue marché de masse » [8]…
Au contraire : 68 en fut le point de départ ! Fausse révolution, vraie pulvérisation. Transformation de la société en une dissociété : le tout-à-l’ego. Mutation de l’homme « familial enraciné » en « individu dans la foule », sans attaches ni foyer stable... Mai 68 a lancé l’idée que toute stabilité était « fasciste », et cette diabolisation du durable [9] a fleuri en tous domaines. L’économique y a vu son intérêt. Le capitalisme s’y est reconnu. Ayant succédé aux pères bourgeois, les fils bourgeois ont séparé la bourgeoisie et les « valeurs traditionnelles ». Ils ont transposé 68 dans le business, comme le pubard ex-trotskiste incarné par Maurice Bénichou dans une merveille de film passée inaperçue en 1997 : La Petite Apocalypse de Costa Gavras. Ce fut l’époque où l’ex-mao François Ewald devenait le philosophe du Medef, sous la houlette d’un autre soixante-huitard passé au néocapitalisme : Denis Kessler.
Ainsi a surgi ce que Luc Boltanski et Ève Chiapello, dans leur enquête parue à la fin de la dernière année du XXe siècle, ont appelé Le nouvel esprit du capitalisme [10]:
« Nous avons voulu comprendre plus en détail […] pourquoi la critique […] s’éteignit brutalement vers la fin des années 70, laissant le champ libre à la réorganisation du capitalisme pendant presque deux décennies […], et pour finir, pourquoi de nombreux soixante-huitards se sentirent à l’aise dans la nouvelle société qui advenait, au point de s’en faire les porte-parole et de pousser à cette transformation. »
Quelle physionomie a cette nouvelle société ? Stiegler l’indique : « Puisque le désir est le moteur qui nous fait vivre et nous meut (ce qui détermine en profondeur notre comportement), le capitalisme de consommation cherche par tous les moyens à en prendre le contrôle pour l’exploiter comme il exploite les gisements pétrolifères : jusqu’à épuisement de la ressource… »
Mais d’abord, cette forme de capitalisme devait « détourner la libido des individus de ses objets socialement construits par une tradition, par les structures prémodernes comme l’amour de Dieu, de la patrie, de la famille. »
Boltanski et Chiapello (1999) confirmeront ainsi la vision de Boutang (1966) sur l’absence inéluctable du « père » et du familial – matrice de toute société – dans la société nouvelle :
« La famille est devenue une institution beaucoup plus mouvante et fragile, ajoutant une précarité supplémentaire à celle de l’emploi et au sentiment d’insécurité. Cette évolution est sans doute en partie indépendante de celle du capitalisme, bien que la recherche d’une flexibilité maximale dans les entreprises soit en harmonie avec une dévalorisation de la famille en tant que facteur de rigidité temporelle et géographique, en sorte que […] des schèmes similaires sont mobilisés pour justifier l’adaptabilité dans les relations de travail et la mobilité dans la vie affective… [11] »
Alors que son idéologie prétendait « contester la société de consommation », 68 a préparé le terrain au triomphe absolu de cette société. Car le centre nerveux de l’esprit de 68 n’était pas idéologique, mais psychologique, sous la forme d’un double rejet :
- le rejet du familial (avec une virulence dont se souviennent les lecteurs du Charlie Hebdo des grandes années) ;
- le rejet du spirituel (avec la même virulence, n’en déplaise à feu Maurice Clavel qui fut seul à voir le Saint-Esprit sur les barricades du 3 mai).
Rejeter le familial et le spirituel, c’était rejeter l’essentiel de la condition humaine et nous soumettre à un sort injuste : « nous forcer à passer nous-mêmes à côté de notre propre vie, et ainsi laisser la promesse de vie s’enfuir dans la banalité pour finir dans le vide [12] ». Une telle mutilation révoltait Patrick Giros, qui allait mourir à la tâche au service des SDF : « Rendez-vous compte, cette logique soixante-huitarde, que je connais parce que je suis un des fils de 68, eh bien les premières victimes qu’elle fait ce sont les petits, les jeunes, les fragiles, ceux qui ont une famille explosée, ou des fragilités psychologiques… [13] »
Or ce rejet soixante-huitard du spirituel et du familial, est aussi le centre nerveux de la société consumériste. Celle-ci réduit le monde humain à la consommation matérielle individualiste (une fuite en avant égocentrique : une vie réduite à l’insatisfaction acheteuse). Elle ampute l’existence de dimensions qui sont les clés de la condition humaine.
Là est l’imposture de Mai 1968 : s’être présenté comme l’ennemi de la société de consommation, alors qu’il anéantissait tout ce qui freinait le triomphe de celle-ci.
L’esprit de 68 a vomi tout ce qui n’était pas le caprice individuel (d’où le célèbre slogan : « il est interdit d’interdire »). Il ouvrait ainsi la voie au matérialisme mercantile. Celui-ci allait se substituer à tout, en installant : 1. le caprice individuel comme ressort du marketing ; 2. le marketing comme seul lien du vivre-ensemble... Ainsi les slogans de 68 furent récupérés en bloc par le marketing, et ce fut la naissance de la sous-culture des années 1980-2000 : plus besoin de chercher le sens de la vie, il suffisait d’être « soi-même », de « penser avec son corps », de se contenter d’exister, de « bouger » – et finalement, d’acheter. Le marketing ne demandait rien de mieux aux consommateurs : ne plus se poser de questions, devenir dociles et ductiles.
Ces noces de Mai et du Marché auraient horrifié, dix ans plus tôt, les soixante-huitards extrêmes : ceux qui rêvaient d’abolir l’argent, d’en revenir au troc et de proclamer « l’An 01 » avec le dessinateur Gébé. Pourtant c’est ce qui est advenu... Cela n’aurait pas étonné le vieux Marx, qui félicitait le capitalisme (cent trente ans plus tôt) de son pouvoir de destruction-innovation :
« La bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c'est-à-dire l'ensemble des rapports sociaux. […] Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l'époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux […] se dissolvent […] Tout ce qui avait solidité et permanence s'en va en fumée. [14] »
Les sociaux et les mondains
Alors, critiquer Mai ? Oui. Mais n’en faisons pas un prétexte. Ne disons pas que tout va bien aujourd’hui ; ou qu’il suffirait, pour que tout aille mieux, de liquider l’esprit de 68.
Je préfère être avec Benoît XVI, lorsqu’il demande que l’on change le modèle économique global [15].
Et avec les évêques de la planète catholique, lorsqu’ils appellent à lutter contre « des injustices qui crient vers le ciel » [16].
Et avec les anciens soixante-huitards qui ont lancé en France l’économie solidaire… Ceux-là ont su ne pas suivre l’esprit de 68 dans son transfert ultralibéral. En se faisant entrepreneurs sociaux, ils ont à la fois pris le contrepied du matérialisme mercantile et de 1968 (la « déconstruction » ravageuse).
La fusion de 1968 et du consumérisme ne légitime pas le consumérisme ; le triomphe actuel du consumérisme ne nous dispense pas de chercher des solutions pour en sortir.
À gauche de la gauche, quelques-uns commencent à voir le rôle de l’esprit de 1968 dans l’hypermarché qu’est la société présente. Ainsi le journal La Décroissance [17] donnant la parole au maire de Grigny (Rhône), René Balme, qui accuse le slogan « interdit d’interdire » d’avoir ouvert un boulevard à la marchandisation de tout : en effet, dit-il, la libre concurrence « ne doit être bridée par rien »… Le psychiatre Jean-Pierre Lebrun ajoute : « Beaucoup de gens sont aujourd’hui dans une grande confusion, car ils croient être débarrassés des interdits. Si plus rien n’est interdit, plus rien ne veut rien dire. » Selon Lebrun, spécialiste des comportements, la « stratégie néolibérale » disloque la condition humaine en niant que les limites soient « utiles et fondatrices » ; elle fait ainsi « sauter les verrous les uns après les autres » : « Le néolibéralisme […] dans son versant consumériste donne l’illusion que l’on peut avoir accès facilement à la satisfaction de nos prétendus besoins, et cela sans aucun renoncement. Mais la vie humaine ne se résume ni à cette satisfaction, ni à ces prétendus besoins. »
m
Beaucoup de gens trouvent que la société de consommation ne pose aucun problème. Ce n’est pas mon avis, mais ce que vous venez de lire n’est qu’un regard personnel.
Il y a d’autres regards...
Leur diversité et leur confrontation sont un service que rend ce livre. Car l’heure vient de réparer l’un des pires dégâts collatéraux de Mai : avoir pollué l’exercice du débat dans ce pays. L’esprit de 68 ajoute en effet à ses caractéristiques celle d’être futile et manichéen en même temps. Il brandit la dérision, mais il voit le monde en noir et blanc. Camp du Bien contre camp du Mal ! Dans ce climat, les nuances disparaissent et l’échange d’idées devient impossible : il n’y a que des imprécations, des anathèmes contre les horreurs ultimes et les abominables relents dont on affuble l’adversaire. Personne n’est plus en mesure d’analyser les données, de faire la part des choses. Quarante ans après 68 on est toujours dans cette ornière : quand le professeur Alain Badiou proclame, en chaire, que « Sarkozy est le nouveau nom du pétainisme » [18], c’est 1968 qui continue ; toujours la manie de l’exorcisme (« CRS - SS ») substitué au raisonnement... Et quand Jean-François Kahn fait rire tout le monde en 2007 avec cette entrée de son Abécédaire mal pensant [19]:
« – ‘‘Abject’’ : équivalent à ‘‘contestable’’ dans les livres de Bernard-Henri Lévy »…
…les lecteurs songent-ils que la démesure dans l’invective est un legs de Mai 68 ?
m
En 2006, je dînais dans une grande ville française avec le patron d’un quotidien régional et sa femme. Lui et moi avions presque le même âge. L’épouse était plus jeune. Après nous avoir écoutés évoquer le joli mois de mai, elle nous a coupé la parole :
– Au fond, la génération de 1968, vous emmerdez tout le monde depuis quarante ans ?
Nous lui avons répondu :
– C’est assez vrai.
En une époque de repentances, celle de notre génération n’a pas eu lieu et ne semble pas près de se faire.
Un psychanalyste télégénique déclare en octobre 2007 : « Je suis resté fidèle aux idéaux de 1968 ». Il explique : «J’avais 16 ans et j’ai vécu cette période comme une déflagration. La vie intime, qui jusque là était forclose, a jailli d’un coup dans la société… » Ce soixante-huitard impénitent a réussi dans l’existence (souligne Libération) : « Parisien aisé, entre un appartement dans le 3e arrondissement et des voyages en Inde avec ses enfants, il devient assez logiquement un pur bobo : ‘‘Au test du Nouvel Observateur, j’ai toutes les réponses positives, de la marque de café au lieu de vacances’’. »
Quelques jours après, Le Monde consacre une page entière à raconter le plus grand mariage de la saison. L’article s’intitule : « Carnet mondain de la nostalgie »… En effet le marié fut un héros de Mai, il est eurodéputé aujourd’hui et il a convié huit cents personnes à la noce : toute l’élite parisienne, tous anciens de 68 ! Entre autres un psychanalyste médiatique (un de plus), qui jubile et déclare à ses voisins de table : « Si on n’est pas invité ce soir, on n’existe pas socialement. »
Deux mois plus tard, un joaillier de la rue de la Paix annonce une « nouvelle collection seventies ». Sur sa pleine page de pub, on voit une top-model qui lève le poing avec un bracelet de platine et une bague de diamants ; sourcil froncé, oeil dur, lèvres ouvertes comme pour un cri, la créature mime une attitude de manifestante. Derrière elle on voit un ciel bleu, sur lequel se détache – en petites capitales couleur blanc-nuage – le slogan du magasin : « militant de l’impertinence ». Le folklore de Mai est devenu un argument de vente.
Oui, 68 a changé la vie.
Non, la repentance n’est pas dans l’air.
P.P.
3. Sorti en 2008.
5. La Nation française, 19 janvier 1966.
6. Comprendre le capitalisme (Le Nouvel Observateur hors-série, mai 2007).
7. Le Monde, 22 novembre 2002, à propos du livre de Michéa Impasse Adam Smith (Climats).
8. Ed Vulliamy, The Observer, 30 septembre 2007.
9. Douée pour récupérer ce qui la conteste, la rhétorique économique allait (plus tard) s’emparer de la formule « développement durable ». Mais où sont les réalisations concrètes ?
10. Gallimard 1999, 843 pages..
11. Boltanski, op.cit.
12. Josef Ratzinger, La mort et l’au-delà, Fayard 1994.
13. À la rencontre des personnes de la rue (« Aux captifs la libération »), de Jean-Guilhem Xerri, Nouvelle Cité 2007.
14. Manifeste de 1848.
15. novembre 2006.
16. Synode universel, octobre 2005.
17. Décembre 2007.
18. Dans son cours à l’ENS pendant la campagne présidentielle de 2007.
19. Plon, 2007.
07/04/2008 | Lien permanent
Lettre de Michéa sur le mouvement des gilets jaunes
23/11/2018 | Lien permanent
Le vrai visage du libéralisme - Une lecture de Michéa [1]

Jean-Claude Michéa, L'empire du moindre mal - Essai sur la civilisation libérale (Climats 2007), relu par Serge Lellouche :
(Dans la synthèse ci-dessous, la formulation reprend largement celle de JC Michéa, souvent mots pour mots)
- L'unité du libéralisme : Le mouvement historique qui transforme profondément les sociétés modernes doit être compris comme l'accomplissement logique (ou la vérité) du projet philosophique libéral, tel que défini depuis le XVIIe siècle. Autrement dit, le monde sans âme du capitalisme contemporain constitue la seule forme historique dans laquelle cette doctrine libérale originelle pouvait se réaliser dans les faits, aussi bien dans sa version économiste que dans sa version culturelle et politique. Telle est la thèse centrale de ce livre.
Deux précisions préalables s'imposent avant de la défendre : il s'agit de distinguer les intentions des auteurs classiques des effets politiques et civilisationnels que leur système de pensée a inévitablement contribué à produire.
Parler de « logique libérale » implique de traiter le libéralisme en en unifiant philosophiquement les principes, par delà la diversité réelle de ses auteurs et de ses courants, et à rebours d'une grande partie de la gauche qui aimerait opposer un «bon » libéralisme (celui de la libéralisation permanente des mœurs et de l'avancée illimitée des droits) à un « mauvais » libéralisme (économique).
Le libéralisme, n'empruntant aucune de ses articulations majeures aux traditions philosophiques antérieures, est l'idéologie moderne par excellence, nullement donc «conservateur » ou « réactionnaire » par essence. Il est indispensable, pour en comprendre la logique, de revenir sur les sources du projet moderne.
Dans cette combinaison complexe de causes contingentes, une place essentielle (mais non première, on le verra) doit être réservée à l'invention de la science expérimentale de la nature. C'est surtout en tant qu'image d'une autorité symbolique nouvelle, l'idéal de la science, autorité désormais opposable à celle de l'Eglise, que la physique galiléenne a produit ses deux effets idéologiques les plus importants. D'une part, elle a offert une assise métaphysique à la notion de Progrès ; d'autre part, elle a favorisé la croyance en la possibilité d'une extension de la méthode galiléenne vers une «physique sociale» créant les conditions d'un traitement enfin «scientifique» et «impartial» du problème politique.
Adam Smith est un des premiers penseurs à exploiter ce nouveau modèle et à proposer une théorie systématique des stades du développement de l'humanité, dont la croissance économique est la base et le moteur.
Pourtant, malgré son rôle fondamental, ça n'est pas à partir de l'idéal de la science que se sont véritablement déclenchées les dynamiques de la modernisation. Ce modèle n'a été si rapidement convoqué au service de la résolution du problème politique, que dans la mesure où ce dernier se posait au même moment sous des formes historiques entièrement inédites.
Le catalyseur de la réponse moderne, c'est avant tout le traumatisme historique extraordinaire provoqué chez tous les contemporains par l'ampleur et la durée des guerres du temps. Les guerres dramatiques des XVIème et XVIIème siècles ont défini l'horizon de la vie des hommes. Les armes nouvelles rendent les affrontements particulièrement meurtriers. Surtout, et de façon totalement inédite à ce degré d'intensité, la guerre est civile et idéologique, principalement sous la forme des guerres de religion. La nature même des rapports humains en est affectée en profondeur : la guerre civile, par définition, introduit les divisions les plus désocialisantes qui soient. Les esprits sont habités par la hantise de la guerre, la crainte de la mort violente, le refoulement de tout ce qui entoure la mort, la peur du voisin, le rejet des fanatismes religieux.
Ces sentiments sont essentiels dans la genèse du libéralisme, et les Modernes ne vont plus cesser de revendiquer une «nouvelle manière d'être», un désir de vie enfin tranquille et pacifiée. La seule «guerre» qui demeurera concevable dans le nouveau dispositif philosophique, telle une guerre de substitution, est la guerre de l'homme contre la nature.
La croyance moderne au Progrès est fondamentalement le signe d'une aspiration très prosaïque à vivre enfin en paix, loin des agitations meurtrières de l'Histoire, dans la recherche d'une amélioration des conditions de vie individuelles.
La question de la pacification idéologique de la société, permet de mieux penser l'originalité absolue du projet moderne et surtout l'unité profonde des deux figures philosophiques sous lesquelles le libéralisme va porter ce projet à son accomplissement logique.
La capacité de sacrifier sa vie (voir Eric Desmons, Mourir pour la patrie ?, PUF, 2001), a toujours constitué la vertu proclamée des différentes sociétés traditionnelles. A contrario, la modernité occidentale apparaît comme la première civilisation de l'Histoire faisant de la conservation de soi, le premier voire l'unique souci de l'individu raisonnable et l'idéal fondateur de la société. Comme dit Benjamin Constant : «le but des modernes est la sécurité dans les jouissances privées ; et ils nomment liberté les garanties accordées par les institutions à ces jouissances » (De la liberté des Anciens comparée à celle des modernes, 1819). On ne saurait mieux dire que la liberté que vont célébrer les libéraux n'est d'abord que l'autre nom d'une vie tranquille et si possible agréable.
Afin de fonder philosophiquement ce projet politique dans l'optique de ce programme, il s'agit donc de définir impérativement les conditions anthropologiques de la pacification recherchée. Selon l'interprétation dominante du temps, le désir de gloire des Grands et la prétention des hommes à détenir la Vérité sur le Bien, sont les deux principales causes de la folie meurtrière. Le désir de gloire et le culte des vertus héroïques sont donc présupposés être le masque de l'amour-propre, et il est établi que nos convictions concernant le Vrai, le Beau ou le Bien ne sont pas universellement communicables.
Il s'agit au fond d'une anthropologie de la lassitude, et c'est bien dans ce cadre précis que l'essence de l'Homme va commencer à être lue à travers le modèle du « bourgeois », ce négociant bien commode que toute l'époque s'accorde maintenant à définir comme prosaïque, paisible et inoffensif.
On peut maintenant exposer dans sa logique constitutive, le double mouvement parallèle qui conduit le libéralisme philosophique à proposer l'utopie d'une société rationnelle, plaçant le fondement même de son existence pacifiée dans la seule dynamique des structures impersonnelles du Marché ou du Droit. Ces deux versions parallèles ne sont pas seulement liées dans les faits ; il existe une nécessité structurale qui conduit chacune d'elles à rechercher en permanence ses appuis théoriques l'une sur l'autre. Le libéralisme est dès l'origine un tableau philosophique à double entrée.
Dans les deux versions, la démarche consiste à découvrir les mécanismes capables d'engendrer par eux-mêmes tout l'ordre et l'harmonie politiques nécessaires, sans qu'il n'y ait plus jamais lieu de faire appel à la vertu des sujets. Ce processus sans sujet est la condition de toute société tranquille.
Selon l'axiome de base du libéralisme politique, puisque la cause fondamentale de la violence est la prétention des individus à détenir la vérité sur le Bien, le Pouvoir chargé d'organiser leur coexistence doit donc être philosophiquement neutre. Chacun est libre de ses valeurs, de ses croyances et de son style de vie, sous la seule condition que ses choix soient compatibles avec la liberté correspondante des autres. L'instance chargée d'harmoniser les libertés à présent concurrentes, c'est le Droit : «Prions l'autorité de rester dans ses limites ; qu'elle se borne à être juste. Nous nous chargerons d'être heureux» (Benjamin Constant).
Le Juste prime donc sur le Bien, selon la thèse libérale. Mais plutôt que d'une « théorie de la justice » (sur laquelle se fonde le Droit), il conviendrait de parler d'une théorie de l'ajustement, décrivant les combinaisons institutionnelles les plus efficaces permettant l'équilibre des libertés rivales, et se limitant à définir les conditions techniques d'un simple modus vivendi. L'Etat le plus juste, serait en cela l'Etat qui ne pense pas, et qui constitue, selon la formule de Saint-Simon, une pure « administration des choses », cantonné dans un idéal de neutralité axiologique absolue, cœur même du projet libéral.
Emmanuel Kant note dans son «Projet de paix perpétuelle», que dans l'hypothèse d'un travail législatif parfait, la seule mécanique du Droit suffirait à assurer la coexistence pacifique même d'un peuple de démons.
C'est ici que les ennuis du libéralisme politique commencent. Aucun des premiers libéraux n'aurait célébré comme le terme logique de la liberté l'avènement d'un « peuple de démons » ; le problème c'est que rien, dans la logique du libéralisme politique, ne protège ce dernier contre une telle éventualité. Le droit libéral ne se réfère pour l'exercice de la liberté qu'à la seule nécessité de ne pas nuire à autrui. Or ce critère se révèle, à l'épreuve, d'un maniement pour ainsi dire impossible.
Selon ce critère, de quel droit, la société libérale pourrait-elle empêcher un individu de se nuire à lui-même (par la drogue ou autre...) ? Si l'on fonde son jugement sans recours à la moindre valeur ou éthique, de quel droit critiquer la marchandisation du corps? Et les questions sont multipliables à l'infini, au sujet de la coexistence des religions, sur le statut de la femme ou de l'homosexualité au sein de chacune de ces religions ; questions faces auxquelles le droit libéral est en grande difficulté. La multiplication des «problèmes de société» est manifestement impossible à résoudre dans le cadre strictement technique qu'il s'est lui-même imparti.
Toutes les revendications, y compris celles les plus contraires au bon sens ou à la common decency, peuvent donc s'engouffrer dans cette brèche d'un mode de raisonnement juridique minimaliste, et transformer tous les scrupules éthiques possibles en autant de tabous arbitraires et historiquement déterminés. Il est donc inévitable que ce processus d'extension indéfinie des droits finisse par déclencher, selon la vieille dialectique provocation/raidissement, l'apparition d'une nouvelle guerre de tous contre tous, menée cette fois-ci devant les tribunaux et par avocats interposés.
Nous sommes aux antipodes de ce monde paisible dont rêvaient les fondateurs du libéralisme, mais c'est pourtant bien au nom de leur théorie du droit et de la liberté que ce besoin forcené de tout légaliser se développe à présent sans limites. Tel est le fruit d'un Etat libéral qui se veut «le scepticisme devenu institution» (Pierre Manent).